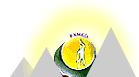| |
|
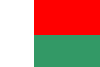
|
MADAGASCAR
La beauté et la misère
Jacques Blais
Suite et FIN |
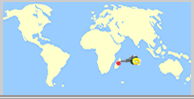 |
|
|
| |
Les premiers lémuriens
C’est encore dans le Sud. Il nous faut abandonner la route unique, encombrée de camions et de marcheurs, de charrettes et de troupeaux, pour enfoncer le 4X4 dans un sentier épouvantable, une piste défoncée, terriblement difficile, aux dénivelés de blocs de roche en escalier périlleux, aux torrents à traverser, aux passages laborieux et ardus, une quinzaine de kilomètres véritablement interminables, pour atteindre le Camp Tsara.
Le Tsara Camp est un camp de toile fixe, formé de quelques tentes de type militaire, assez hautes pour y tenir debout, groupées près d’une tente plus vaste servant de salle à manger. Un peu, en infiniment moins luxueux, le style de certains camps de safari kenyans par exemple. Chaque tente est jouxtée d’un local entouré de paille, proposant une douche de campagne, sous forme d’un container suspendu empli d’eau par le personnel et déversant son liquide par une pomme, et de toilettes chimiques.
Le site est étonnant et superbe, fait d’une muraille circulaire de basalte noirci, assemblage de très grands blocs de roche surplombant la place circulaire du camp, également idéalement niché entre une anse de rivière et un bois épais d’arbres dans lesquels gîtent les lémuriens. Au matin, un nuage dense et blanc occupe la paroi sombre, un crachin attriste un peu le décor. Mais la longue balade de plusieurs kilomètres à travers la forêt apporte le bonheur de débusquer quelques lémuriens.
Il existe de nombreuses variétés de ces singes à longue queue. Des lémuriens, diurnes pour la plupart, mais des espèces nocturnes se trouvent dans le Nord, des blancs, des roux, et les plus habituels, à queue rayée, nommés Catta, tandis que les bondissants Sifaka sont repérés ici à Tsara. La difficulté est de les trouver, mais les guides sont entraînés à écouter leurs cris de rappel, mi claquement de langue, mi intonation un peu sifflante. Et en se montrant très silencieux, les visiteurs entrant sur leur territoire les découvrent, par familles de cinq ou six, accrochés aux branches, sautant de l’une à l’autre ou flânant.
Madagascar conserve sur son territoire 90 % des lémuriens de la planète, et pratiquement toutes les variétés de ces ancêtres des singes. Cette découverte entre dans le domaine des émotions, car à la différence des visites de jardins zoologiques, nous sommes devenus les invités humains humbles et modestes de ces prédécesseurs évoluant sur un terrain que est le leur, intrus dans leur vie quotidienne qu’ils laissant alors observer.
Un autre camp, encaissant dans la faille d’un torrent plus au nord ses huttes de bois sous les arbres, présentera certaines espèces très petites à la mobilité essentiellement nocturne, dans un cadre de nouveau très humide mais intéressant.
Au soir venu, le spectacle est offert par les aigrettes, ces oiseaux blancs qui s’adonnent à des envols collectifs, suivis d’escales sur le sommet des arbres feuillus et foncés, créant un décor de fleurs artificielles du plus bel effet, dont on ne se lasse pas.
Et c’était l’heure des aigrettes blanches,
Avant que le jour ne disparaisse
Sous des nuées à formes rondelettes.
Les oiseaux blancs gardaient les branches
Après un vol lent de paresse
Qui, d’un coup d’aile, les projette,
Comme progressent d’un coup de hanche
Certains poissons que l’eau caresse.
Comme une porte dont la clenche
Libère ces elfes qui se pressent,
Se précipitent les aigrettes.
Et toutes volent, nulle ne flanche,
Elles voilent les arbres qui se dressent
Et que le soleil déjà regrette.
Et c’est une vraie avalanche,
Des fleurs immaculées qui tressent
Un tissu blanc qu’on interprète
Comme une nappe de dimanche,
Un doux décor que rien n’agresse.
Et le soir envahir les crêtes,
C’est l’heure réjouie des aigrettes blanches
Et les instants disparaissent.
La nuit a dit qu’elle était prête.
Tous ces oiseaux habillent les branches
De bruissements et de souplesse,
Autant de fleurs sur des baguettes
Cette escale au Camp Tsara est quelque peu hors de l’espace, à la fois retour sur un monde des origines, pureté des lieux préservés, et la blancheur de ces oiseaux vespéraux ajoute une touche de joliesse naturelle spectaculaire.
|
| |
Les Hauts Plateaux
La région des cultures débute avec Fianarantsoa, une ville ancienne fondée vers 1830, installée sur les pentes donnant sur les premières cultures variées. Cette ville a conservé de beaux bâtiments dits coloniaux, vieilles demeures entretenues jusque dans la cire de leurs parquets, chambres humides et belles sur des balcons ouverts sur les terrasses de plantations, jardins de bananiers, nostalgie des richesses et des décors d’antan. Plus haut vers la route du nord rejoignant Tananarive, les véhicules rencontrent Antsirabe, également une ville assez structurée, sans grâce réelle mais témoignant d’un passé presque cossu. C’était il y a bien longtemps. Antsirabe est aussi connue pour son envahissement par les pousse-pousse, traduisant cette origine asiatique de Madagascar, et le site est entouré de sources. Une petite fabrique artisanale montre encore une très ancienne méthode de fabrication d’un papier de végétaux compressés, écorces d’Havoa et plantes, qui produit le « papier antemoro » une sorte de faux parchemin sur lequel des ouvrières dessinent des motifs de fleurs par collages.
Les Hauts Plateaux approvisionnent pratiquement le pays entier en légumes, carottes, pommes de terre, choux, bien entendu énormément de riz également, sur des cultures en terrasses bien entretenues. Ces dispositions végétales créent un paysage somptueux, alternant de vastes pentes légumières et des monts alternés, des reliefs prononcés striés de murets, de pans plus arides, et cette succession de longues pentes, de montagnes déclives, de murs granitiques, et d’étendues de cultures de verts différents fait de cette région une suite de vues vraiment magnifiques et séduisantes.
|
| |
Une terre pour les baobabs
Ces évocations végétales mènent à parler des baobabs, qui représentent encore une des caractéristiques de Madagascar. Toujours la même réflexion sur des latitudes identiques, et de surcroît l’origine accolée de ces continents dans les ères très reculées de notre terre, le Nord-Ouest Australien montre une variété, nommée Boab là-bas, qui est la variété grise à tronc droit et branches étagées d’un bout à l’autre, et une variété en bulbe grise également. Ces baobabs là se retrouvent sur Madagascar à partir du tiers nordique de l’île. Sur une petite zone de la côte ouest, reliquat d’une véritable forêt, et tout au Nord autour de Diego-Suarez (ou Antsiranana, en Malgache), on découvre une autre variété, brune, très haute, en espalier, à tronc en forme d’aubergine, un peu bulbeux mais allongé.
Les baobabs sont véritablement d’étranges et fascinantes créatures. Une allure de danseuses indonésiennes, avec leurs bras à l’horizontale et leurs doigts retournés aux extrémités. Ou bien cet aspect d’espaliers mâtinés de portemanteaux. Ou encore, diront les mauvaises langues, d’épouvantails. Parfois la prestance impressionnante de ces marionnettes africaines géantes , figures de carnaval à la Jean-Paul Goude, avec juste une touffe de poils en houppette sur le crâne, ou ces robes pansues de majesté pour de si petits bras.
Les baobabs sont rois. Comme des arbres plantés à l’envers, racines au ciel, ou des tubercules hypertrophiques et leur bouquet de feuilles. Ils sont là et on ne peut les ignorer, d’ailleurs ils n’aimeraient pas, ils plastronnent et fanfaronnent. Installés, dominant, quand ces pauvres humains poltronnent et ronronnent, décalés, ruminants. Ce sont des nababs, les baobabs…
|
| |
Diego-Suarez
J’ignore pourquoi ce nom de ville m’a depuis toujours, étonné, fasciné sans doute, marqué en tout cas dans mon refus de toute géographie scolaire des années de lycée. Et il m’aura fallu me rendre sur place pour apprendre l’imposture : l’appellation de ce port du Nord de Madagascar résulte en fait de la réunion arbitraire et réductrice de deux noms de conquérants, Diego Diaz le navigateur connu pour bien des découvertes, et Herman Suarez débarquant à quelques années de distance, dans les années 1500, dont on a accolé un prénom et un nom pour nommer l’endroit.
Une ville attractive, désuète et vieillotte, avec ses rues coloniales caractéristiques, ses anciens bâtiments maritimes, militaires, palais détruits et demeures cossues délabrées, et puis cette baie presque circulaire attractive et particulière. Certains voudraient la comparer à Rio ou à Sydney, n’exagérons rien, ces deux lieux du monde, très différents mais grandioses et lumineux, baie époustouflante de splendeur pour la Brésilienne, et impressionnante de lumière et d’espace pour l’Australienne, ont une dimension, une fascination, une échelle que la gentille baie de Diego ne saurait égaler. Mais ce demi-cercle très bien fermé et protégé, avec ce mini pain de sucre central, est séduisant, et la bordure de plage boisée du sémaphore vespéral des baobabs bruns fichés dans les buissons, à proximité de cet ancien hôtel de luxe redevenu escale à l’échelle humaine, dans son allure de film en noir et blanc, confère à l’endroit une jolie allure un peu mélancolique et dérisoire.
Les couchers de soleil éclairent de façon renouvelée ces sites de leurs lueurs oranges, et celui qui vient s’installer dans sa précarité sur la superposition du pain de sucre et des si vieux arbres, reflété sur la baie, laisse à penser, à rêver, à fantasmer…
Cet instant doux où le soleil s’enfuit
Et le moment suspendu qui s’ensuit,
La montagne vient juste de prendre sa douche
Et la lune l’a prise en douce dans sa bouche…
Cet instant roux où apparaît la nuit
Et les moments suspendus à ces bruits ,
Le soleil s’apprête à prendre sa couche
Et la mer se vide comme à la louche…
Cet instant flou où le fond du ciel luit
Et le firmament suspendu à lui,
Le vent se lève et prend la mouche
Et le temps éternel prend souche…
Une autre belle baie logée sur la côte nord-ouest amène face à l’île de Nosy Be, et permettra de gagner ce refuge en bateau. Un endroit à la belle eau d’un bleu-vert agréable, aux rivages de fleurs et de plantations, une enclave de tranquillité.
|
| |
Le massif de l’Ankarana
Tous ces lieux du Nord conservent une culture imprégnée de l’installation arabe de quelques 15 % de la population. Et en particulier les tombes portent ces traces. Vastes, cubiques ou parallélépipédiques, bétonnées, décorées abondamment, elles ressemblent, pour ces tombeaux définitifs familiaux, à leurs homologues trouvés dans les pays où l’Islam règne. Les Malgaches enterrent d’abord leurs morts lors de fêtes solennelles dans les flancs ou les falaises de montagnes, sous des amas de pierre, en des lieux protecteurs peu accessibles, où ils les laissent quelques années, deux généralement. Puis intervient la fameuse cérémonie, grandiose, très importante et symbolique, dite du retournement des morts. Un retournement à plusieurs sens. Initialement l’idée que les membres des familles vont retourner auprès de leurs défunts, qu’ils ne sauraient oublier. Ensuite un premier retournement physique, consistant à prendre les corps et les entourer pour le transport dans des nattes, des tapis, et un retour, troisième étape, vers le lieu définitif familial, ce grand tombeau où le mort trouvera sa place, la chaleur des proches, le respect de tous.
En bordure de la côte nord-ouest, un abondant massif élevé de calcaire et de granit, résultat de la plicature au moment des modifications des continents, probable conséquence d’un volcanisme aussi dont témoignent dans l’île plusieurs très beaux lacs circulaires de cratères emplis d’eau aux couleurs violentes, crée un bloc long de plusieurs kilomètres, falaise considérable infranchissable, hérissée des pics issus de l’érosion et des fusions, de ce remue-ménage ancien de fabrication du territoire.
C’est le massif de l’Ankarana. Très peu exploré ou visité, parce que très difficile d’accès, dépourvu de toute structure d’accueil, tout comme d’eau, le séjour nécessite de vivre en spartiate quelques jours. Isolés dans des clairières à l’intérieur du massif, hébergés en camp de toile terriblement succinct, petites tentes ordinaires, et contraints d’apporter l’eau, des lampes à pétrole, de la nourriture, les visiteurs sont au cœur de nulle part.
Une longue et difficile marche crapahutante, aléatoire et délicate par endroits, simplement astreignante et laborieuse dans la plupart, permet de progresser vers plusieurs buts de visite. Une piscine naturelle créée par l’érosion, des véritables sculptures des roches tendres devenant motifs, hypothèses et décors. La traversée de bois touffus offre de nouveau la découverte de lémuriens encore différents, de trois ou quatre espèces un peu farouches.
Et le clou assez épuisant du spectacle est apporté par ces formations appelées les Tzingys, qui sont des aiguillées de basalte découpées sur un plateau de la formation calcaire mêlée de concrétions grisâtres, un spectaculaire champ de pics drus et serrés étalés sur une grande longueur. Avec ce perpétuel besoin de comparer, mais ceci également dans un but d’illustration explicative, qui a vu Bryce canyon aux États Unis aura une idée de ce que représente ce lieu. A la couleur près, car Bryce est orangé, en raison d’un sol d’ocre comme à Roussillon dans notre midi, quand ces Tzingys sont gris. Enserrant un cratère d’eau d’un vert de pistache, bordé d’arbres, c’est un coin assez étonnant et méritant la très longue approche pédestre éreintante pour qui n’est pas un adepte de cet exercice.
|
| |
Nosy Be, l’île aux parfums
Nosy Be est une île qualifiée, comme tant d’autres, de paradisiaque. Elle regroupe les joies des plages blanches, un peu artificielles, les retrouvailles pour les nostalgiques, avec des champs de canne à sucre, de très jolies fleurs tropicales dans de nombreux jardins, une ville balnéaire aux productions artisanales de broderies dans des lingeries de draps, serviettes, nappes. Elle est très prisée des Italiens, qui l’envahissent de leurs restaurants, de leurs surfs, de leurs soirées musicales.
Au risque de me voir taxé de snobisme ou de prétentieux délicat et blasé, il m’est apparu rapidement que Nosy Be, dotée de bien des qualités, est une île qui pêche très vite par les contreparties habituelles du tourisme de luxe et d’artifice. La population, confrontée à la richesse étalée et au tourisme de loisirs nautiques, adopte les travers de ces lieux, l’accueil s’en ressent en perdant toute spontanéité, et cette gentillesse à toute épreuve des habitants des coins perdus et dignes dans leur misère de la Grande Île.
Et les visiteurs ne montrent plus que le visage le plus effroyable du tourisme riche, dans son horreur. Deux illustrations, pour évoquer et expliquer : un touriste en train de filmer à l’aide de son camescope ultra perfectionné de riche un plat de bananes flambées tout frais apporté par la serveuse d’un restaurant d’archi-luxe pieds dans l’eau, en commentant dans son micro avec ces mots grandioses et inspirés « alors voilà, ce sont les bananes flambées de l’Hôtel… » Et pire, une honte effroyable de partager, même de loin, la nationalité de cet autre touriste, qui ayant un peu trop largement pioché dans le plat de viande, donne au chien massif et futé qui traîne à proximité des tables le superflu, dans un pays où trois personnes sur quatre ne mangent pas à leur faim, où le personnel doit vraisemblablement nourrir à l’aide des restes des familles entières !!
Nosy Be présente, quand on l’apprivoise et que l’on décide de se rendre où personne ne va, en parvenant à convaincre un taxi local terriblement surpris de grimper par les routes à une voie jusqu’au sommet de l’île, l’ancien cône volcanique, une magnifique, splendide vue sur toute sa rondeur, qui réconcilie avec tout.
Des lacs volcaniques au bleu de Lapis Lazuli, des rectangles de riz jaunâtres, la découpe acérée de feuilles de verdure, et celle ténue de ces fines nervures aux facettes discrètes de semis verts, qui donnent aux chemins creux des veines longues, et aux escarpements l’aspect de gerçures, quand les trous drus des points d’eau sont blessures dans les flancs. Un patchwork de pièces et de coutures, la tendresse des rizières qui rythment une lente poussée en chantant la nature et son murmure. L’emprise de la mer devient gangue sur ces quelques plages claires, et la découpe soignée de tendres cultures atteignant de leurs doigts tendus cette mer qui vient mettre son grain de sel. Le brûlis des champs et l’étoupe éloignée de ces cendres futures, ces criques tenant l’île par les aisselles et l’impression, d’en haut, de nacelles suspendues entre le ciel bleu clair et l’océan bleu foncé, fabriquent en permanence un dessin renouvelé.
L’Ylang-Ylang est cette plante particulièrement odorante utilisée pour les préparations de parfums. Elle est faite de buissons d’un vert très sombre et brillant en même temps, comme des vignes de très grande taille, ou des mangroves au contraire réduites, des arbustes denses et touffus qui parsèment de leurs buissons les pentes et les jardins.
Comme tant d’autres lieux au monde, Nosy Be aura été cette escale sur un banc désert au sommet absolu de l’île, les yeux capables alors de parcourir les trois cent soixante degrés du paysage, à laisser simplement s’écouler le temps bercé d’une brise, contemplatif et heureux, ému et tranquille à la fois, avec juste en tête, quelques instants, des paroles d’une chanson de Cabrel qui doit raconter quelque chose de doux, de si quotidien et de si adapté à cet instant précis, pardon si je le déforme un peu : et voilà tout ce que je sais faire, du vent dans des coffres en bambou, des pans de ciel pour mettre à tes paupières, et d’autres pour pendre à ton cou… c’est rien que du ciel ordinaire, du bleu comme on en voit partout, mais j’y ai mis tout mon savoir-faire, et toute notre histoire par en dessous… tu vois c’est presque rien, c’est tellement peu, c’est comme du verre, c’est à peine mieux, tu vois c’est presque rien, c’est comme un rêve, comme un jeu, des pensées prises dans des perles d’eau claire (Texte de Francis Cabrel, extrait de « Presque rien »)
Curieux comme, parfois, j’aurais envie d’affirmer moi aussi « c’est comme des vers, mais c’est tout ce que je sais faire, ce ne sont rien que des couleurs, et puis des fleurs et des douleurs, ou quelques pleurs, mais même si c’est tout j’ai placé des pans entiers de notre histoire au bout…. » Juste pour faire accepter, ou pardonner aux moins amateurs ou aux lecteurs saturés de poésie l’envahissement de certains textes par des rimes…
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|